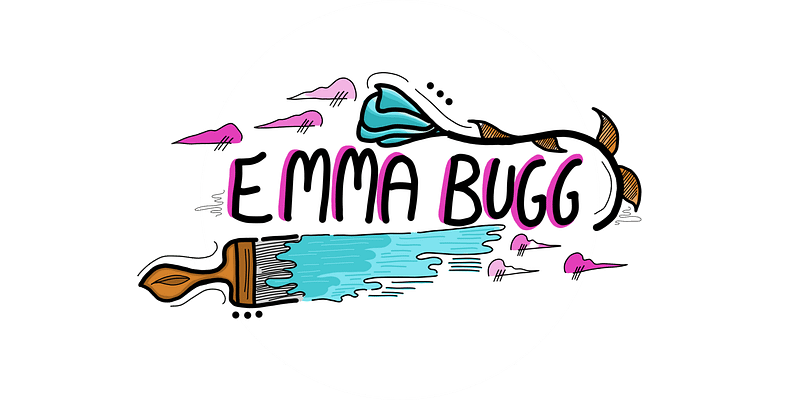1. Pourquoi avez-vous approuvé cette expérience ou étude de cas d’usage?
Dans mon double rôle de gestionnaire des programmes artistiques et environnementaux au Caravan Farm Theatre, j’explore l’intersection entre l’art et l’environnement. Le théâtre produit des œuvres in situ et axées sur le territoire depuis 1978, et ce projet était l’occasion de marier consciemment art et sensibilité écologique. Nous sommes parfaitement conscients des effets de la crise climatique dans notre région, et le Cadre de travail évolutif sur l’incidence climatique pour les organismes artistiques offre justement une approche structurée permettant d’explorer ces enjeux pressants. La décision d’y participer est ancrée dans notre volonté d’intégrer de nouvelles manières de penser et méthodes de recherche dans nos pratiques organisationnelles, en particulier à une époque où la crise climatique occupe une place importante dans la réalité quotidienne de notre collectivité.
2. Qu’est-ce qui a initialement retenu votre attention dans ce cadre?
Ce qui ressortait, c’était l’éventail de questions posées dans le cadre, particulièrement celles concernant les relations humaines et les relations entre les artistes, le public et le territoire. Contrairement à d’autres outils qui évaluent principalement des critères quantitatifs comme les émissions, ce cadre aborde des aspects qualitatifs, comme la façon dont les artistes et le public interagissent avec l’œuvre, ainsi que l’état d’esprit ou les actions qui en résultent. Cette approche nous a parlé en raison de nos relations profondes avec le territoire et la collectivité. Elle offrait une manière d’articuler les expériences uniques que nous offrons, qui permettent aux artistes de vivre et de travailler sur le site et au public de se mobiliser pour l’environnement d’une manière qui va au-delà de l’expérience théâtrale standard.
3. Quels changements le cadre a-t-il entraînés, le cas échéant?
En appliquant le cadre, nous avons pu réfléchir plus intensément à l’incidence de notre travail, surtout en ce qui a trait à la mobilisation du public et des artistes pour les enjeux environnementaux. Nous avons privilégié les questions portant sur la création de dialogue, les échanges uniques avec le public et la promotion d’autres façons d’interagir avec la nature. Les données recueillies en sondant le public et les réflexions du personnel nous ont confirmé la nature unique du lien entre les gens, le territoire et la collectivité. Ces perspectives montraient l’importance de créer une communauté, surtout pendant des événements météorologiques inattendus lors de spectacles en plein air, et la façon dont ces expériences peuvent favoriser un sentiment profond de participation et de connexion au sein du public.
4. Quels enseignements tirez-vous de l’application du cadre, le cas échéant?
L’un des apprentissages les plus importants que nous en avons retirés est la prise de conscience de la valeur des expériences partagées lors des spectacles en plein air. Les anecdotes sur des spectatrices et spectateurs s’entraidant durant des conditions météorologiques extrêmes montraient, à petite échelle, l’attitude que nous devons adopter, dans la collectivité, pour faire face à la crise climatique. Ces interactions suscitent un sentiment de solidarité et de résilience, soulignant ainsi l’importance de la collectivité pour relever les grands défis environnementaux. Nous avons aussi appris l’importance de se poser des questions difficiles, même celles qui ne sont pas faciles à quantifier, car elles révèlent souvent de l’information très précieuse.
5. Hormis le manque de moyens, quels obstacles pourraient empêcher un organisme artistique de mettre en œuvre le cadre d’impact?
Outre le manque de moyens, l’un des principaux obstacles était la difficulté à mesurer les aspects qualitatifs, comme les éléments relationnels et les retombées à long terme des expériences. Les critères quantitatifs étant plus faciles à consigner et à rapporter, il peut être difficile de justifier la demande de ressources nécessaires à l’exploration de questions plus profondes. De plus, il y a parfois une réticence à affronter des vérités potentiellement dérangeantes sur l’efficacité des pratiques actuelles. La nature qualitative de ces questions demande du temps et la volonté d’écouter et de s’adapter, ce qui peut s’avérer difficile dans un environnement souvent axé sur les données mesurables.
6. D’après vous, pourquoi est-il important d’encourager la réflexion et l’évaluation dans le travail d’un organisme d’art?
Il est crucial, pour les organismes artistiques, d’encourager la réflexion et l’évaluation, car celles-ci servent le public et contribuent au bien-être culturel et social de nos communautés. C’est grâce à elles que nous pouvons répondre aux besoins du public et des parties prenantes, et préserver la pertinence et l’intégrité de notre travail. L’évaluation continue nous aide à nous adapter et à nous améliorer, nous permettant ainsi de répondre efficacement aux problèmes complexes auxquels nos communautés sont confrontées, comme la crise climatique. Elle contribue également à favoriser la confiance et la transparence auprès de notre public et des parties prenantes, ce qui renforce la valeur de notre travail.
7. Pour quels types de situations ou d’organismes ce cadre pourrait-il être utile?
Ce cadre pourrait être utile à tout organisme du domaine des arts et de la culture, particulièrement ceux qui cherchent à intégrer la durabilité environnementale dans leurs pratiques. Il peut être particulièrement utile pour les organismes des régions rurales ou fragiles sur le plan environnemental, où les effets de la crise climatique se font davantage sentir. Cependant, l’application de ce cadre ne se limite pas aux enjeux environnementaux; elle peut aussi aider les organismes à explorer d’autres aspects sociaux et politiques qui touchent leur communauté.
8. Avez-vous des conseils concernant la mise en œuvre?
Il est bon de commencer par cerner les questions difficiles que l’on n’aborde pas présentement et que l’on a peur de se poser. Cette approche vous encouragera à explorer de nouveaux aspects et vous aidera à recueillir de l’information précieuse. Il s’agit aussi de s’ouvrir au soutien et à l’apprentissage sans crainte du jugement. Il est essentiel de créer un environnement propice, où des conversations difficiles peuvent avoir lieu. N’hésitez pas non plus à adapter le cadre pour inclure d’autres enjeux que les préoccupations environnementales, car celles-ci sont souvent liées à d’autres facteurs sociaux et politiques. Enfin, ne perdez pas de vue l’engagement communautaire et l’entraide; cela pourra vous aider à concilier la durabilité opérationnelle et l’incidence sociétale en général.